Propos recueillis par Samuel Blumenfel, en juillet 1993 pour les Inrocks
Vos romans évoquent de manière récurrente le travail de la terre et l’immigration suédoise dans le Midwest.
Jim Harrison – Ma mère était suédoise, du nord du pays, tout près du cercle arctique. Elle venait d’une famille très pauvre arrivée en Amérique à la fi n du siècle dernier. Mon père était d’origine irlandaise et anglaise, une famille de bûcherons, mais lui était fermier. Il a ensuite quitté sa ferme pour devenir ingénieur agronome, il était chargé de donner des conseils aux fermiers sur des problèmes tels que la conservation des sols ou la productivité des récoltes.
Vous êtes né à la fin des années 30. Quels souvenirs gardez-vous de l’entrée en guerre des Etats-Unis ?
La peur. J’avais un correspondant en France à qui j’écrivais régulièrement, Jacques Chornay. Je lui envoyais des colis avec des vivres. Je me souviens très bien de ses lettres. Si ça se trouve, il est encore vivant, je serais très curieux de savoir ce qu’il est devenu. On priait chaque matin pour les enfants français. J’ai été élevé dans la hantise que les Allemands puissent un jour envahir l’Amérique. Encore aujourd’hui, les Japonais et les Allemands me rendent nerveux. Je me souviens avoir été dans l’ex-Union soviétique dans les années 70. Je faisais la queue dans un offi ce de tourisme. Devant moi, un homme d’aff aires allemand drapé dans un manteau de fourrure hurlait depuis une demi-heure car personne ne lui répondait. Puis, tout d’un coup, une voix anonyme s’est écriée : “Tu te souviens de stalingrad et des dix millions de morts russes ?”
Dalva, Faux soleil, Légendes d’automne parlent du retour à la terre. Vos parents ont quitté la campagne pour la ville quand vous étiez très jeune. Quelle a été l’importance de ce changement ?
Cela a été très difficile pour moi, venant du Nord-Michigan, de descendre vers le sud. J’avais à peine 15 ans, mon père a accepté un poste à l’université. Nous étions cinq enfants. En suivant notre père, nous avions tous la possibilité d’aller au collège. Il faut savoir que là où nous vivions, nous avions à peine les moyens de nous payer nos études au lycée. C’est au collège que j’ai découvert la littérature française. A 18 ans, j’avais déjà lu tout Apollinaire, Rimbaud, Valéry, Péguy, Breton dans leur traduction anglaise. Je suis retourné aujourd’hui à la campagne et j’ai encore l’impression de me trouver dans les années 50, comme si rien n’avait vraiment changé. Il y a encore des loups et des ours, c’est un sentiment très réconfortant de vivre parmi eux. Tom McGuane dit : “il faut habiter là où vivent les grizzlis et les requins marteaux.”
Vos livres ne sont-ils pas un prolongement du mouvement hippie des années 60, qui prônait le retour à la terre ?
Tout vient de Neil Young et de sa chanson, Are You ready for the Country?, qui nous a causé un tort considérable. Après l’avoir écoutée, un tas de gens ont quitté la ville pour la campagne. Pour ma part, je connaissais déjà la vie à la campagne. Mais tous ces citadins se sont ramenés, ils ont essayé de cultiver des jardins et de faire pousser de l’herbe qu’ils ont fumée jusqu’à se rendre malades. Les conceptions de ces gens me font marrer. Il n’y a pas d’un côté l’homme et de l’autre la nature. Les deux se confondent. C’est pour cela que je trouve absurde la position des militants écologistes. La nature vide et sauvage n’a jamais existé : avant l’homme blanc, il y avait les Indiens et, avant eux, peut-être encore d’autres hommes. Il faut arrêter de romantiser la nature. Cela dit, je n’ai rien contre Neil Young. J’ai beaucoup écouté sa musique à l’époque où je passais mon temps à Key West, juste avant de partir travailler pour Hollywood. On retrouve dans sa musique la même chose que dans Dalva : le désir de mystère, le romantisme dans la vie, éviter la merde, la banalité, les médias et le bruit des motos qui m’empêchent de vous parler correctement depuis le début de cet entretien.
A la fin de L’homme qui abandonna son nom, le personnage de Nordstrom laisse tomber sa vie de businessman pour vivre dans une cabane en Floride et se consacrer à la danse. L’écriture était-elle, comme la danse pour Nordstrom, un moyen d’échapper à la monotonie de l’existence ?
Il y a tellement de gens qui se perdent dans leur vie professionnelle et se laissent bouffer par les problèmes matériels. Quelle est la part du rêve dans tout cela ? Je ne pourrai jamais me ré- soudre à vivre entièrement dans la réalité. Vous connaissez The Teachings of Don Juan (L’Herbe du diable et la petite fumée) de Carlos Castaneda ? Vous vous rappelez donc de l’histoire de ce type qui cultive son champ de maïs. Il passe toute sa vie dans ce putain de champ et ne cesse de se plaindre. A la fin du jour, il entend son chien aboyer, ce qui signifie que sa journée est terminée. Sa vie aussi d’ailleurs. Il peut donc aller se coucher, en attendant de retourner travailler le lendemain. Je ne veux pas vivre comme ce type. Je préfère être un imbécile heureux ou un ivrogne.
Gamin déjà, je ne pensais qu’à écrire. J’ai fait plusieurs métiers. J’ai creusé des rigoles d’irrigation et je suis évidemment passé par tous les travaux de la ferme. J’ai été également détective privé. J’avais été engagé pour retrouver une fille qui avait disparu dans le Nord-Michigan. J’ai su par la suite qu’elle avait été tuée, j’ai même eu son assassin en face de moi. Le type était vraiment effrayant : il avait un sexe de femme tatoué sur sa joue et des biscoteaux énormes. Je me suis directement inspiré de cette expérience pour bâtir le personnage du privé dans Sorcier, un roman que je n’aime pas d’ailleurs. Je l’ai écrit dans un état de grande fatigue et je traversais, à l’époque, une période très difficile de mon existence.
J’adore Raymond Chandler et John D. MacDonald. L’attitude du privé me plaît, car il se lève chaque matin avec un problème à résoudre. L’existence n’est pour lui qu’un grand mystère. J’aime croire que la vie n’est pas une chose banale et qu’il y a partout un sens caché, des événements inexplicables ou surnaturels. Même si on sait que ce n’est probablement pas vrai, je tiens à me cramponner à cette idée. Karl Kraus disait que si l’on essayait vraiment de comprendre ce qui se cachait derrière les titres des grands journaux, on finirait par sortir dans la rue pour hurler sa douleur et vomir toutes ses entrailles. Un écrivain se doit de sortir de la banalité. De Huckleberry Finn de Mark Twain émane l’idée qu’il y a toujours quelque part un bout de terre à découvrir. (Jim Harrison ouvre alors sa chemise et me montre un pendentif en terre cuite sur lequel est dessiné un serpent – ndlr). Un ami indien me l’a donné, cela vous permet de rester proche de la terre lorsque vous quittez votre maison. “Reste proche de la terre, sinon tu disparaîtras”, a-t-il l’habitude de me dire.
Une des caractéristiques de votre écriture est le lyrisme. D’un autre côté, vous faites référence à ces hard-boiled writers comme Chandler ou John D. MacDonald. Peut-on qualifier votre écriture de lyrisme hard-boiled ?
Absolument. Prenez Dalva, c’est un livre d’un romantisme très cruel.
Pourquoi être passé de la poésie au roman ? Quelles possibilités vous offrait le roman ?
J’étais chez Tom McGuane – je récupérais alors d’une blessure que je m’étais faite en tombant du haut d’une colline – lorsqu’il m’a dit : “Pourquoi ne profites-tu pas de ta convalescence pour écrire un roman ?” J’ai d’abord mis au point un plan de travail où j’avais défini les grandes articulations du roman. Il est très difficile d’écrire de la poésie, il faut parfois attendre des heures et des heures avant de trouver le mot juste. Il faut, comme l’écrit René Char, “être là quand le pain vient de sortir du four”. Le problème est que vous ne savez jamais quand ce pain est cuit et, en attendant, j’écris des romans. Je ne mets pas le roman au-dessus de la poésie, il s’agit de deux genres très différents qui me semblent capables de susciter autant d’émotion. A moins que vous n’écriviez un de ces romans bourgeois, un de ces best-sellers qui remplissent d’aise le lecteur. Ce type de livre est la pire forme de masturbation qui existe.
Vous appartenez à cette génération d’écrivains américains, avec Crumley et Hillerman, qui n’habitent ni sur la côte Est ni sur la côte Ouest, et écrivent principalement sur le Midwest. En quoi votre position géographique rend-elle votre vision des choses différente ?
Ces mecs de la côte Est ne sont jamais sortis de leurs livres alors que Crumley ou moi avions un vécu avant de nous mettre à écrire. Ils passent leur temps à se regarder le nombril ou à remettre en place leur brushing devant leur miroir. Or, ils ne savent pas qu’il existe un monde derrière ce miroir. J’appartiens à ce monde. Dans ses Carnets, Dostoïevski parlait d’un article relatant le suicide d’une fille qui se serait tuée par ennui. Il faut vraiment venir de la côte Est ou Ouest ou d’une grande ville pour se suicider d’ennui. Je pense être plus proche de Jean Giono que de Norman Mailer, comme Faulkner se rapproche davantage de René Char que de Doctorow. Des écrivains comme John Updike ou Norman Mailer s’apparentent à des club-sandwichs : après avoir avalé une bouchée, vous vous demandez s’il faut vraiment manger le reste de cette saloperie. Je préfère être un cassoulet qu’un club-sandwich. New York est un drôle d’endroit. Déjà, vous ne pouvez pas voir l’océan d’où vous habitez. De plus, qu’est-ce que les New-Yorkais connaissent des Indiens ou des Noirs ? C’est McGuane qui me faisait remarquer après un voyage en Angleterre que les Anglais ne savaient rien de la littérature américaine contemporaine. Les Anglais sont comme les New-Yorkais, d’après McGuane, ils passent leur temps à s’observer sans jeter le moindre regard autour d’eux. C’est comme ces gens qui me disent qu’ils ont été en Afrique. Quand vous leur demandez où exactement, ils vous répondent Marrakech. Et le Kenya ? Le Congo ? Le Gabon ? Le Zaïre ? Pour beaucoup, l’Amérique se limite à New York.
Avez-vous lu Les Journaux de Lewis et Clark, les explorateurs qui en 1803 avaient remonté le Missouri jusqu’à sa source ? Il y avait chez eux une volonté de dresser un inventaire de l’Amérique très proche de votre démarche.
Je connais bien Les Journaux de Lewis et Clark.
Je réalise de plus en plus que ce que je vois dans la nature n’a pratiquement jamais été décrit. Je suis en train d’écrire une nouvelle sur un homme qui, parce qu’il n’aime pas leur appellation, décide de redonner un nouveau nom à tous les oiseaux d’Amérique.
Il ne supporte pas, par exemple, qu’un oiseau puisse s’appeler un rossignol. Il prend alors son carnet et décide de changer son nom. Vous ne trouvez pas absurde qu’un oiseau puisse être traité de rossignol ? Ce que fait ce type avec son carnet et ses nouveaux noms ressemble vraiment à la démarche de l’écrivain. Lorsque vous écrivez, il faut faire comme si la littérature n’avait jamais existé avant vous, sinon vous êtes piégé. A chaque fois que vous écrivez un roman, il vous faut réinventer le genre. C’est là que Faulkner se révèle beaucoup plus fort qu’Hemingway. Ce dernier, après ses premiers romans, était devenu un écrivain européen et, du coup, il a perdu une partie de son authenticité. Je ne parle pas ici d’absurdités comme le nationalisme ou le régionalisme, mais il me semble important de rester fidèle à ce que l’on est.
Comment arrivez-vous à restituer l’espace américain dans vos livres : en voyageant, en prenant des notes, des photos ?
L’essentiel de mes notes est composé d’images mentales. C’est pour cela que je conduis si souvent sans jamais savoir où je vais. J’ai récemment pris ma voiture pour parcourir près de 15 000 kilomètres, uniquement sur des routes de campagne. La seule manière de m’imprégner du paysage. En m’enfonçant ainsi sur ces petites routes, j’arrive aussi à mesurer le temps qui passe, à oublier mes problèmes et la banalité de l’existence. Je conduis en général le toit ouvert, en sortant le plus souvent possible ma tête de la voiture.
Il m’arrive parfois d’apercevoir un coyote couvert du sang des animaux qu’il vient de tuer. Il est là, au bord de la route, il me regarde passer : j’ai alors enfin le sentiment intense d’appartenir au paysage.
Le paysage américain, son relief, n’a pratiquement pas changé. Les ours sont toujours là, même si la présence des hommes doit parfois leur poser des problèmes. Il y a une espèce d’oiseaux à laquelle je suis très attentif : les grues couronnées. Cette espèce n’a pratiquement pas évolué en vingt mille ans. Elles volent toujours de Sibérie vers le Nord-Michigan et se réunissent chaque année – elles sont à peu près un million – sur la Platte River, dans le Nebraska. Qu’est-ce que ces oiseaux ont à faire de nous ? Absolument rien.
Est-ce que Lewis et Clark sont seulement passés à côté de la maison de mon ami Russell Chatham (peintre américain qui a illustré un des recueils de poésie de Jim Harrison, Théorie et pratique des rivières – ndlr) dans le Montana ? Il y a beaucoup de grizzlis où il habite, ce qui rend sa maison dangereuse ; encore que les grizzlis soient autant un danger pour les hommes que pour eux-mêmes. Un de mes amis vit vraiment parmi les grizzlis. Il était revenu traumatisé du Viêtnam après avoir bombardé par erreur un village où s’étaient réfugiés une centaine d’enfants. Une fois revenu au pays, il a décidé de vivre parmi les animaux. Tous les Indiens de la région le connaissent, ils l’ont même fait membre de leur “clan ours”. Je me souviens avoir pris un verre avec lui dans un bar. Nous étions en train de discuter quand deux hommes ont commencé à se bagarrer, il s’est alors approché d’eux et leur a dit en hurlant : “Bande de cons, vous n’avez pas remarqué qu’on essayait de discuter.” Les deux types, effrayés, ont détalé comme des lapins.
Il y a trois voix dans Dalva : celle de Northridge à travers son journal, celle de Michael et celle de Dalva. Avez-vous eu des problèmes pour adopter le point de vue de Dalva, la seule voix féminine du livre ?
Très difficile. J’avais d’abord prévu de tout écrire du point de vue du grand-père de Dalva. Seulement, Dalva m’est apparue en rêve, elle était sur le balcon de son appartement de Santa Monica, et ensuite je l’ai revue nue en train de se baigner dans une rivière. Sa voix ne cessait de me parler. Au début, je ne voulais pas que les lecteurs sachent que j’avais rêvé d’elle, c’est pour cela que je n’ai pas voulu publier les carnets rédigés quand j’écrivais Dalva. Mais on ne peut rien faire contre des rêves pareils. Je me suis demandé si ce n’était pas ma sœur morte qui revenait dans mes songes. J’ai perdu mon père et ma sœur dans un accident de voiture, elle avait 19 ans, lui 53. Tony Hillerman dit qu’un homme a toujours une sœur jumelle dont il se sépare à la naissance. Je me demande si Dalva n’est pas un fantôme qui revient soudainement à la surface. Ne me prenez pas pour un fou mystique, mais nous savons si peu de choses du monde dans lequel nous vivons…
Les principaux personnages de Dalva se définissent en fonction de la guerre qu’ils ont vécue : la Première Guerre mondiale pour le grand-père de Dalva, la Seconde Guerre mondiale et la Corée pour son père, le Viêtnam pour Duane, son amant et demi-frère. Quelle est votre guerre ?
(Jim Harrison me montre l’œil qu’il s’est crevé au cours d’un accident de montagne – ndlr.) C’est ma seule blessure. A 19 ans, j’avais mis de côté tout mon argent pour aller en France, mais j’ai tout dépensé pour pouvoir me payer une opération chirurgicale à l’œil. Cette intervention n’a eu aucun effet. La seule guerre que j’aie connue est la vie. Cela dit, la Seconde Guerre mondiale m’a profondément marqué. J’ai bien sûr participé à des marches contre la guerre du Viêtnam. D’habitude, plus les gens vieillissent, plus ils deviennent conservateurs, mais moi c’est l’inverse, je suis de plus en plus à gauche. La lecture des livres sur l’histoire de l’Amérique a fini par me taper sur la tête. Dans ce pays, les Indiens ont été encore plus mal traités que les Noirs.
Dalva va s’établir dans la ferme familiale aux confins du Nebraska et du Dakota du Sud, région qu’elle considère comme “le ghetto de Varsovie des Sioux”. C’est une comparaison extrêmement violente.
C’était volontaire. C’est comme si l’Allemagne avait gagné la guerre aux dépens des Américains. C’est le son des marches militaires nazies que l’on entendrait dans l’immensité de l’Ouest. Dans la plupart des westerns, les cowboys sont célébrés comme de véritables héros de guerre, alors qu’ils ont été des assassins sanguinaires. C’était toute la signification du scénario que j’avais écrit sur Edward S. Curtis (photographe américain du début du siècle qui avait entrepris de photographier les Indiens d’Amérique du Nord – ndlr). Il s’agissait d’observer à travers Curtis la dégénérescence du Westerner. Curtis est un authentique artiste, car il renouvelle complètement l’imagerie des Indiens. Vous voyez les Iroquois du Minnesota avec leurs capes en peau de grizzli, les Tuesas avec leurs corbeaux sur la tête et leurs peintures sur le visage. Ces gars n’ont vraiment pas une gueule à voter républicain. On nous a toujours appris qu’on était tous les mêmes ; c’est faux, nous sommes tous différents.
Dans Dalva, le parallèle que vous faites entre le massacre des Indiens et le génocide des Juifs n’est-il pas un peu trop schématique ?
Vous avez raison, c’est pour cela que dans Dalva je m’en tiens à cette comparaison avec le ghetto de Varsovie. Je trouve très dangereux de banaliser l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà une différence énorme : les Indiens ont été massacrés sur une période de deux cents ans, alors que le génocide juif a été commis en quelques années avec des moyens industriels. Mais le silence qui a entouré le massacre des Indiens et le génocide du peuple juif est le même. La cupidité a été le moteur essentiel du massacre indien. On les déplaçait de territoire en territoire ; quand ils ne voulaient plus bouger, on les tuait. Ce meurtre tirait toute sa légitimité du fait que c’était Dieu qui nous avait donné cette terre. Robert Frost, l’un des conseillers de Kennedy, déclarait : “Cette terre nous appartient, il n’y avait rien avant que nous arrivions.” S’il y a une morale dans Dalva, elle se trouve dans le dicton sur lequel s’ouvre le livre : “Nous aimions la terre, mais nous n’avons pas pu rester.” Je suis un écrivain, je ne suis pas un Indien. Mon engagement se fait d’abord dans l’écriture – il faut bien faire la part entre l’idéologie et mes livres. C’est pour cela que je crois que Le Journal d’Anne Frank vaut tous les discours antifascistes, ou que toute l’œuvre d’Isaac Bashevis Singer en dit plus sur notre monde que tous les discours prononcés à l’O.N.U. Cela n’a donc pas d’importance que Dalva ait été écrit par un Blanc ou Dieu sait qui, ce qui compte c’est que le livre ait atteint sa cible.
Pourquoi la plupart de vos personnages, Nordstrom dans L’homme qui abandonna son nom, Strang dans Faux soleil, tiennent-ils leur carnet ou leur journal intime ?
Je tiens à échapper à ce genre de littérature où cela fait bien d’avoir des personnages qui sont de parfaits idiots. Les gens intéressants écrivent souvent leurs pensées sur un carnet. Je suis très attiré par ce genre littéraire qu’est le journal intime, ou même plus prosaïquement des notes éparses écrites au jour le jour. Comme si les choses n’avaient plus aucun rapport entre elles, il ne reste plus que des notations presque surréalistes. Je me sens aujourd’hui très proche de ce style d’écriture ; je m’aperçois désormais que les choses ne collent jamais ensemble et que c’est à nous de recoller les morceaux d’une réalité qui nous échappe en permanence. Quand j’écrivais mes Carnets de Dalva, je ne pouvais compter sur rien si ce n’est sur la terre, le soleil, la lune et les étoiles. C’est tout ce que je possède. Vous ne pouvez jamais compter sur une ville. En revanche, un arbre ou une rivière ne vous laisseront jamais tomber. Dans Howl, Allen Ginsberg parle de “cette incroyable musique de la rue”, je pense que, si vous mettez de côté votre personnalité, vous serez plus réceptif à cette musique. La chose la plus importante que j’aie faite depuis sept ans – ma vie avance par cycles de sept années – est d’avoir abandonné ma personnalité. Seule votre voix compte et, si vous arrivez à la préserver, vous avez une chance d’échapper aux tourments et aux lamentations du quotidien. Tant que je garderai ma voix, je sais que je ne serai jamais un de ces paumés qui ne savent pas quoi faire de leur vie.
Propos recueillis par Samuel Blumenfel, en juillet 1993
Un bon jour pour mourir (A Good Day to Die)
C'est la merveilleuse histoire d'un virée fantastique à travers l'Amérique des années 1960. Un trio inoubliable, très Jules et Jim, prend la route, entre un joint et deux cuites pour s'en aller faire sauter un barrage du côté du Grand Canyon du Colorado.
Traduit par Sara Oudin
Nord Michigan (Farmer)
Fils d'un émigré suédois, le héros de ce roman exerce la profession d'instituteur dans une bourgade rurale du Michigan. Il partage ses loisirs entre la chasse, la pêche et les nuits avec Rosalee, son amie d'enfance. Mais survient Catherine, une de ses élèves, elle a 17 ans et va bouleverser le cours de sa vie. Sur ce thème presque banal Harrison a composé un roman simple et beau.
Traduit par Sara Oudin
Dalva (Dalva)
La route du retour (The Road Back Home)
Ces deux romans forment un tout, constituant une vaste fresque à travers la vie d'une famille de pionniers pendant cinq générations. C'est l'histoire de l'Amérique depuis les guerres indiennes jusqu'à nos jours. Dans ces deux romans les genres épique, lyrique et dramatique alternent tour à tour. Jamais Harrison n'avait aussi bien évoqué ce mélange de sacré et de profane absolu qui constitue selon lui le sens de l'existence
Traduits par Brice Matthieussent
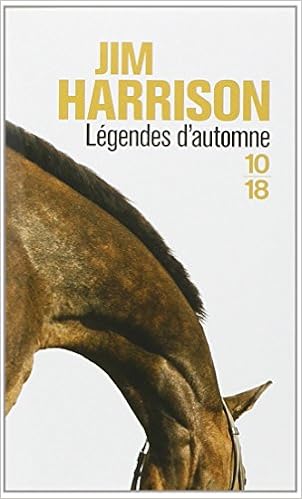
Légendes d'automne (Legend of the Fall)
"Ces trois légendes traitent essentiellement de vengeance, de doute et de rédemption. Bien que ces histoires soient marquées de brutalité et de fracas, chacune à sa manière présente un plaidoyer contre la violence. Pour ses héros elle est un ultime recours. Comme dit l'un d'entre eux : "Les hommes qui méritent vraiment de mourir sont finalement assez rares". Serge Lentz
Traduit par Serge Lentz




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire