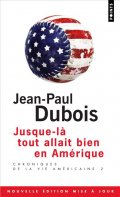Paul est de retour. Il y a longtemps que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Cinq ans, je crois. Et puis voilà un nouveau livre, un peu comme une lettre de mon vieil ami "libertaire" qui aurait atterri dans ma boite aux lettres. Un ami que je fréquente depuis 1992, année où une bonne amie m'a offert "parfois je ris tout seul". Et comme l'a écrit ce bon Gustave : "ce fut comme une apparition". J'ai vite rattrapé le retard qui nous séparait en avalant les six livres qui précédaient. Eh puis, après, il m'a fallu patienter pour lire cet auteur discret et penser à cette bonne amie perdue. je lui ai emprunté le titre d'un de ses romans pour une de mes nouvelles, et un autre pour le libellé d'une chronique de ce blog. J'espère qu'il m'excusera de ces emprunts.
Ce weekend, j'en ai appris un peu plus sur lui, quoi que tout cela soit déjà dans la plupart de ses livres, dans l'article et l'entretien qu'il a accordé au journal "les Echos weekend" à l'occasion de la sortie de son roman "La succession" aux éditions de l'Olivier.
"Jean-Paul Dubois parle aux tondeuses.
Une en particulier, de marque Briggs & Stratton. Quoiqu'elle ne
serve plus, il l'entretient encore avec soin et fait tourner le moteur
une fois par an. Cette tondeuse a une histoire qui pourrait figurer dans
un de ses romans. « Un jour, un transporteur me livre une énorme
caisse de trois cents kilos. Je refuse qu'il la dépose sur ma pelouse,
mais il insiste "Vous verrez, Monsieur Dubois, ça vous fera plaisir,
ouvrez". Je finis par accepter tout en prévenant que si ça ne me
convenait pas, je refuserai la livraison. Sur ce, je découvre cette
énorme machine. Il y avait une lettre de mon éditeur chez Robert
Laffont, Vincent Landel, qui disait : "Chez nous, tu n'auras jamais de
prix littéraire alors on a décidé de te remercier en te décernant le
prix Briggs & Stratton." Il faut dire qu'il y a souvent des
tondeuses dans mes livres. Voilà, pour moi, c'est ça la vie. La vie, ça
se construit avec un rien, une bricole. »
Pour être complet, ajoutons que Jean-Paul Dubois parle aussi aux bateaux et aux voitures. «
J'ai un rapport maladif aux choses. J'essaie de tisser un rapport avec
elles, d'autant plus que les engins que j'ai eus n'ont jamais été très
fiables. Je passe 80% de mon temps à les réparer. Ma fille m'appelle Mac
Gyver. Alors je me dis que si je leur parle bien, ils vont se comporter
avec une certaine loyauté mécanique à mon égard. » Dans son nouveau roman, La Succession,
le personnage principal, prénommé Paul, comme dans beaucoup de ses
livres, possède un bateau asthmatique qui lui fait de misères au large
de Miami et une Volkswagen Karmann-Ghia de 1961 à travers le plancher de
laquelle on peut voir défiler le macadam. « Toutes les voitures
dans mes livres, sont des voitures que j'ai eues. La Karmann-Ghia, je
l'ai achetée à Miami à un pompier, je suis allé la chercher au Havre et
redescendu avec à Toulouse. J'ai eu de vieilles MG, des Volkswagen, une
Triumph Vitesse. Je pleurais chaque fois en les vendant. Une fois, j'ai
tenté de racheter un bateau que j'avais vendu. J'ai retrouvé sa trace,
il est au mouillage, peinard, au-dessus de La Rochelle ».
Le père de Jean-Paul adorait acheter
des voitures. Il allait chercher son fils à la sortie de Caousou,
collège toulousain tenu par les jésuites, et l'emmenait au garage. «
Je ne savais jamais ni de quelle marque ni quel modèle elle serait.
Juste qu'elle serait assez puissante pour tracter son camping-car. Mon
père était un type singulier. Il a vendu des amplis de puissance, monté
un studio d'enregistrement - j'ai toujours le piano dans mon salon -,
importé du matériel hi-fi. Il était très bohème, à la fois triste et
drôle. Il avait pris la vie comme un terrain de jeu. Il venait d'une
famille aisée, tandis que ma mère était fille de berger. Ma grand-mère
vendait des fruits et légumes sur le marché. » Ce père cachait un secret. Toute sa vie, il n'avait cessé d'écrire. « Il y en a une malle entière au grenier. Je n'ai rien voulu lire. Ces pages, je ne les lirai jamais, c'est à lui. »
On ne s'étonnera pas si presque tous ses romans - en particulier La Succession -parlent de famille, de filiation et de transmission. «
La famille, c'est un fardeau, le seul truc sur lequel tu ne peux pas
agir. Tu peux choisir ta vie amoureuse, ton métier, mais la famille,
c'est la loterie. Tu nais dans un univers qui va conditionner la moitié
de ta vie, comme une maladie génétique. Tu ne peux pas enlever un
chromosome. J'ai eu une enfance inquiète, mon père était âgé et
souffrait d'une maladie cardiaque. La nuit, je me levais pour vérifier
qu'il respirait. L'inquiétude, le doute, la peur sont le moteur de mes
livres avec aussi l'envie de vivre et la volonté de se battre. »
Jean-Paul garde un souvenir épouvantable de Caousou, des brimades, de la contrainte et des humiliations. «
Au lieu de t'apprendre le beau, le phénoménal, l'intelligent, on
t'apprend le latin... Hic, haec hoc... Aujourd'hui encore, j'ai des
déclinaisons entières dans la tête... » En conséquence, il décide
du principe qui régira sa vie : ne pas dépendre de l'autorité d'un autre
et ne pas exercer d'autorité sur les autres. L'écriture lui paraît la
solution idéale « Quand je lui ai dit que je serai journaliste, mon
père m'a répondu : "J'aurais encore préféré que tu rentres dans la
police". Il aurait voulu que je fasse l'ENA, au moins que je sois
fonctionnaire. »
Le futur prix Fémina n'a pas ouvert un livre de toute son adolescence. Il forge sa culture à la lecture de Hara-Kiri, de La Gueule ouverte et du Pop Club de José Artur, « le seul endroit où la culture arrivait audible pour les mecs de mon âge. Ça sortait du cadre qu'on nous imposait ». Après, il passe à l'Internationale situationniste. « Je ne comprenais rien. Mais c'était "contre " et ça m'allait, ça stimulait l'intelligence, le désir. »
Jean-Paul Dubois apprend le métier de journaliste à Sud-Ouest
où il couvre les matchs de foot de l'UST qui évolue en deuxième
division. Ça tombe bien. Avec son père, il fréquente le stade
Ernest-Wallon dans le quartier des Ponts-Jumeaux. Il est fou de rugby.
Dans sa chambre d'enfant, il organise des France-Angleterre de légende.
Il est incollable sur le Stade Toulousain. Le journalisme sportif se
révèle une redoutable école d'écriture. « Tu dois écrire en temps
réel, au milieu de 20 000 types qui hurlent autour de toi, pour que ton
papier arrive avant le bouclage. Après ça, tu n'as plus jamais
l'angoisse de la page blanche. » Ce sera ensuite Le Nouvel Observateur
où, sans quitter longtemps Toulouse sauf pour ses grands reportages aux
Etats-Unis, il jouit d'une extrême liberté. « "L'Obs" était taillé sur
mesure pour mon style de vie. Mais en fait, même le journalisme, je
n'étais pas fait pour ça. Dès que j'ai pu vivre de mes romans, j'ai
arrêté. On me disait que c'était impossible de vivre de ses livres. Mais
si on est malin, si on est têtu, on y arrive. Au bout de vingt ans, j'y
suis arrivé. J'ai eu raison de ne pas lâcher. Un jour, je suis passé de
20 000 lecteurs à 200 000, je ne sais pas pourquoi. »
Le premier livre est né d'un défi, celui de battre le record de Boris
Vian qui disait avoir écrit un roman en vingt-cinq jours. Dubois écrit
donc en vingt-quatre jours Compte-rendu analytique d'un sentiment désordonné - refusé par tous les éditeurs avant d'être publié au Fleuve noir. « J'étais un peu vexé d'être pris par un éditeur de polar, mais j'avais gagné mon pari, c'était fini. »
À la suite d'un article paru dans L'Obs, Vincent Landel lui
demande un livre sur les gauchers. Il l'écrit à toute vitesse sur une
Japy rouge. Après un passage miraculeux chez Pivot, les ventes
explosent. Entre 1987 et 1993, Dubois publie huit livres chez Robert
Laffont, avant de rejoindre brièvement Le Seuil, puis sa filiale, les
éditions de l'Olivier dirigées par Olivier Cohen. Son style, son
univers, portent la marque des écrivains américains qu'il aime, Raymond
Carver (dont Cohen a publié les oeuvres complètes), Charles Bukowski,
John Fante, Jim Harrison, John Updike. « Pour moi qui n'étais pas un
lettré, leurs livres m'étaient accessibles. Ils parlaient d'un monde
qui m'était extrêmement familier, que je comprenais tout de suite. Ces
types sentaient les choses comme moi. Updike, m'a libéré la tête, j'ai
lu ses 37 livres, y compris celui sur le golf. J'aurais aimé l'avoir
comme professeur. Il apprend à prendre son temps pour raconter une
histoire. C'est une DS 21. »
Fidèle
à sa technique des débuts, JPD écrit tous ses livres en un mois, au
rythme de dix pages jusqu'à quatre heures du matin. Après quoi, il peut
vivre sans contrainte le reste de l'année en attendant de se mettre au
suivant. « La littérature t'offre le moyen de gagner ta vie le moins
douloureusement possible. Ce mode de vie me convient. Le truc, c'est le
rapport au temps. Je n'ai aucune prétention sur ce que je fais, mais je
le fais. Mon seul orgueil, c'est d'être propriétaire de mon temps. Si
tu veux être libre pour vivre ta vie comme tu l'entends, être heureux,
aimer, il faut rogner sur le travail et sur le sommeil. Ta vie, tu ne
sais pas combien de temps elle va durer. T'es dans le tas, ça peut
tomber sur toi à n'importe quel moment. Y'a pas de préavis. »
Avoir du temps, c'est aussi une façon de nourrir ses romans. «
Plus tu traînes, plus tu as de la chance de rencontrer un mec qui est
une histoire à lui tout seul. Être là au bon moment, c'est lié au temps.
» Comme ce plombier qui, tous les matins commençait à lui parler
pendant une heure de sa femme qui venait de le plaquer. Il était
distrait aussi, pouvait oublier de faire une soudure. Les deux hommes se
sont retrouvés dans 20 centimètres d'eau. Sans se démonter, le plombier
a retiré son pantalon pour essorer. L'aventure figure dans l'hilarant Vous plaisantez Monsieur Tanner, en bonne place.
Les personnages de Jean-Paul Dubois, légèrement dépressifs, décalés,
bourrés d'humour se ressemblent d'un roman à l'autre. Ses « Paul »
forcent la sympathie et séduisent les metteurs en scène. Sam Karmann a
adapté "Kennedy et moi", avec Jean-Pierre Bacri. Thomas Vincent "Le Cas Sneijder", devenu La Nouvelle vie de Paul Sneijder, avec Thierry Lhermitte, sorti au printemps, et Philippe Lioret "Si ce livre pouvait me rapprocher de toi", rebaptisé Le Fils de Jean, avec Pierre Deladonchamps, qui sortira en même temps que La Succession. «
Dubois ose séduire à travers des personnages d'antihéros souvent en
équilibre précaire entre le tragique et le dérisoire, toujours empreints
d'un humour dévastateur et salutaire, note Sam Karmann. Ce
n'est pas étonnant que les cinéastes soient attirés par son univers, ses
personnages. Le dépressif est sympathique s'il est lucide. Cette
confrontation à l'encontre de la pensée commune, si ce n'est unique,
provoque l'étincelle qui enflamme la dérision et donc le sourire. Le
pessimisme est le talent de celui qui réfléchit. »
Avant de tourner son film, Thomas Vincent a rencontré Jean-Paul Dubois dans sa maison du quartier de L'Ardenne à Toulouse. «
J'ai eu le sentiment de voir Paul Sneijder. L'accueil était paisible.
Jean-Paul installe une distance de protection face au monde. Il possède
une force de caractère doublée d'une fragilité intime. Il établit cette
barrière que Thierry Lhermitte a aussi. Il me fait penser au Bartleby de
Melville, celui qui dit : "Je préférerais ne pas...". » Philippe Lioret a été séduit par ce désenchantement poussé au paroxysme. «
Il a un ton unique que l'on retrouve chez les grands auteurs
américains. On a toujours le sentiment qu'il vous parle à l'oreille. » Et pas seulement aux tondeuses."
Tous les matins je me lève (1988)
Paul Ackerman se lève tous les matins, mais à midi. C'est un détail
qui change une vie : qui vous met en porte-à-faux avec les autres, un
pas à côté du monde.
Ses nuits, Paul Ackerman les passe à écrire
des romans pour nourrir sa famille et à mener de front, en rêve, une
triple carrière de rugbyman, de golfeur et d'homme-oiseau.
Le reste du temps, il mène une vie qui ne ressemble à rien mais a le mérite de lui ressembler.
Maria est morte (1989)
Sa fille de dix ans est morte en tombant dans
les escaliers. Pour retrouver la femme qui l'a quitté et lui dire
simplement : « Maria est morte, notre fille est morte », Samuel
Bronchowski s'envole pour l'Asie. Au cours de ce voyage épique, il
croisera des vieillards cruels, des muets lubriques, des boxeurs fous,
des femmes sans âge, des êtres étreints par la sottise et la lâcheté. Et
chaque nuit ramènera à son esprit une phrase unique : « Maria est
morte. »